Les antidépresseurs entre mythes et réalités (1ère partie)
Alors que la consommation d’antidépresseurs a encore augmenté, l’efficacité et la pertinence de leur prescription pose question. Le psychiatre Nicolas Hoertel et le médecin Luc Perino en débattent.

A la lecture du dernier rapport de l’Assurance maladie, la consommation d’antidépresseurs apparait comme l’un des effets secondaires de la pandémie. Entre 2019 et 2023, elle a en effet augmenté en France de 60 % chez les jeunes de 12 à 25 ans, qui étaient l’année dernière près de 400.000 sous antidépresseurs. La hausse avait certes débuté auparavant chez les mineurs où l’on avait déjà observé une augmentation de la consommation de ces médicaments de 62 % entre 2014 et 2021. Les années suivantes ont ainsi prolongé une nouvelle tendance qui s’est nettement accentuée avec la crise du covid. Dans les années 2010, la réputation des antidépresseurs avait pourtant été entachée et leur efficacité jugée très hypothétique voire inexistante sur les enfants et les adolescents par une méta-analyse des essais cliniques randomisées effectués sur cette population.
C’est avec ces données en tête que j’ai lu cet été sur Maryanne Demasi, Report un article où la journaliste australienne signait, avec le célèbre professeur de médecine et chercheur danois Peter Gøtzsche, une réponse à une tribune publiée deux semaines plus tôt dans The Conversation par la Canadienne Natalina Salmaso. Psychologue clinicienne et professeur de neurobiologie comportementale, cette dernière s’y emploie à démonter ce qu’elle considère comme cinq mythes sur les antidépresseurs qui feraient hésiter nombre de personnes à les utiliser, en raison de préjugés infondés scientifiquement. Demasi et Gøtzsche s’attachent à réfuter la démystification, en soutenant que la mauvaise réputation des antidépresseurs s’avère fondée, les mythes étant en fait des réalités.
Cette passe d’armes éditoriale m’a donné envie de débat sur ce sujet qui a pris une ampleur considérable après l’arrivée à la fin des années 1980 d’une nouvelle génération de médicaments : les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS). Ils avaient alors provoqué une explosion de la consommation d’antidépresseurs avec une multiplication par plus de six en une quinzaine d’années. Ces ISRS se sont ainsi positionnés dans les années 2000 comme des produits phares de l’industrie pharmaceutique tandis que la dépression devenait une maladie extrêmement rentable, comme l’a symbolisé le succès planétaire du Prozac. Mais en étant prescrit à plus de quatre millions de Français, principalement par des généralistes, ces ISRS interrogent aujourd’hui sur leur usage, pas forcément réservé à des patients déprimés au sens clinique du terme.
De l’EBM et de ses limites en santé mentale
J’ai donc réuni pour débattre de la réalité de ces supposés mythes deux médecins ayant un point de vue et un positionnement différent sur les antidépresseurs. Le premier, Luc Perino, généraliste à la retraite mais aussi essayiste et spécialiste de la médecine clinique, enseigne à l’Université Claude Bernard de Lyon l’histoire et l’épistémologie de la médecine et décrypte dans ses livres et sur son site internet les dérives du système sanitaire et du marché de la santé. Il est aussi président de l’Association pour le contrôle des psychotropes et l’aide aux victimes (ACOPAV), très critique sur l’usage des antidépresseurs.
Le second intervenant est psychiatre et prescrit au quotidien des antidépresseurs. Jeune professeur de médecine à l’AP-HP, Nicolas Hoertel est aussi chercheur et auteur de nombreuses publications scientifiques. Durant la pandémie, il a beaucoup publié sur le potentiel de certains ISRS pour traiter le covid, après avoir observé dès l’hiver 2020 que les patients sous antidépresseurs de l’unité de psychiatrie de la personne âgée où il exerçait, ne faisaient quasiment pas de forme grave. Ceci l’a conduit à mener études et recherches avec des scientifiques et des médecins en France et à travers le monde. Notamment avec des biologistes allemands qui ont découvert que des ISRS avaient la capacité d'inhiber une enzyme qui contrôle la production de lipides situés sur la membrane des cellules humaines et permettant à des virus ou à des bactéries de les infecter. L’action inhibitrice des ISRS pourrait ainsi aider à lutter contre ces microbes, comme cela a été démontré expérimentalement.
Bien qu’une méta-analyse vienne encore de confirmer tout l’intérêt de l’un de ces antidépresseurs pour soigner le covid, Nicolas Hoertel ne nous parle pas aujourd’hui de son passionnant travail sur le potentiel thérapeutique des ISRS pour les maladies infectieuses. Il évoque plutôt son cœur de métier que constitue la psychiatrie, et plus particulièrement ces épisodes dépressifs subits par ses patients qu’il traite en praticien de l’Evidence base medicine (EBM), cette médecine qui se fonde sur des preuves d’efficacité obtenues lors d’essais cliniques. Luc Perino connaît lui aussi l’EBM et son intérêt pour l’évaluation des médicaments, mais il s’attarde davantage sur ses travers et ses limites qui lui semblent particulièrement prégnantes en matière de santé mentale.
Interrogés sur chacun des mythes ou réalités des antidépresseurs sur lesquels se sont opposés Natalina Salmaso et le duo Demasi-Gotzsche, les deux médecins livrent ici un échange instructif, qui invite finalement à la mesure. En voici la première partie, la seconde étant programmée pour la prochaine livraison de votre lettre Raison sensible.
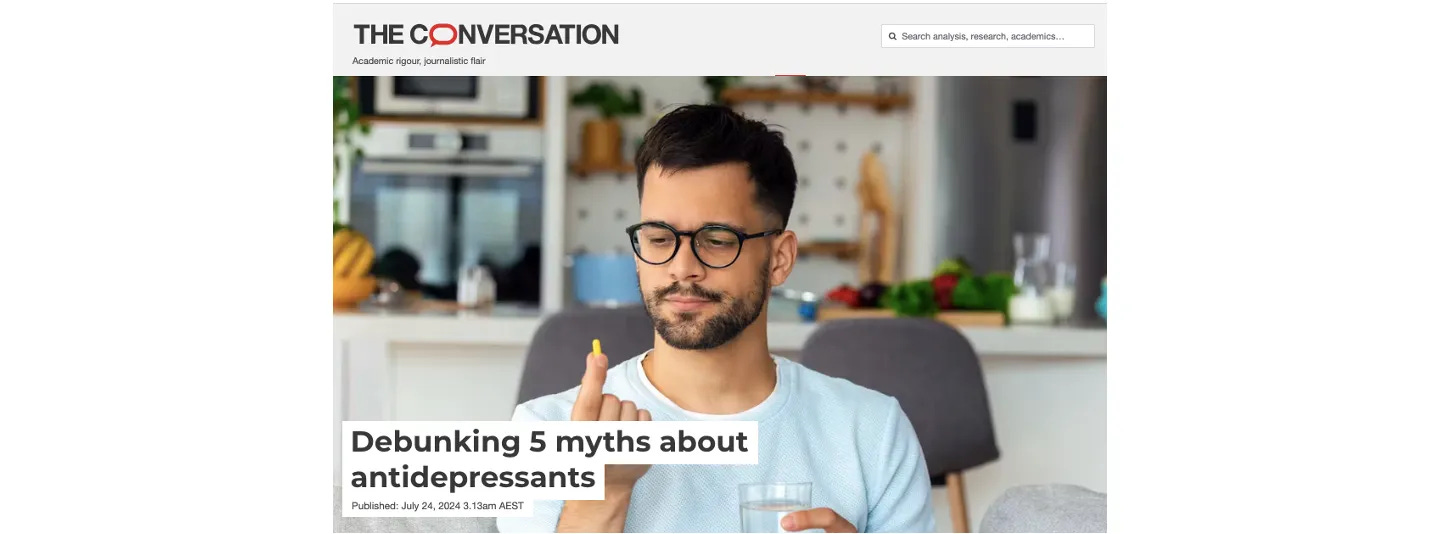
Selon le premier mythe présumé associé aux antidépresseurs, on serait plus fort si l’on ne prenait pas de médicament. Natalia Salmaso objecte que la dépression impacte le cerveau qui ne réagit plus normalement et doit donc être soigné avec un médicament pour fonctionner à nouveau correctement, ce que réfutent Maryanne Demasi et Peter Gøtzsche. Docteurs Perino et Hoertel, qu’en est-il selon vous ?
Luc Perino : En tant que clinicien praticien, ma première réponse est que l’on ne doit jamais donner de médicament tant que l’on n’a pas un diagnostic précis. Si un patient vient me voir et apparaît dépressif, je cherche d’abord à savoir quel est son type de dépression, car il en existe beaucoup, et au moins deux grand types : les dépressions réactionnelles en rapport avec des événements de la vie courante et celles qui entrent dans le cadre d’une maladie psychiatrique plus grave comme le trouble bipolaire. Tant que je n’ai pas ce diagnostic, je m’abstiens de prescrire des médicaments.
Nicolas Hoertel : C’est effectivement un point très important. Un médecin prescrit un antidépresseur selon une balance bénéfice-risque qu’il doit définir grâce aux données issues des essais cliniques randomisés (ECR), à son expérience clinique et aux préférences du patient. En psychiatrie, on n’utilise pas le terme de dépression, car on peut être “déprimé” temporairement pour différentes raisons, et il ne s’agit surtout pas de médicaliser la tristesse. Face à un patient confronté à des événements difficiles tels que la perte d’un proche, prescrire systématiquement un médicament en l’absence de diagnostic peut l’exposer inutilement à un risque. Un psychiatre parle en revanche d’épisode dépressif caractérisé ou de trouble dépressif lorsque l’intensité de la dépression est suffisamment sévère en termes de nombre de symptômes et que celle-ci est associée à une souffrance pour le sujet et à une rupture objective de son fonctionnement. Au-delà d’un certain degré de sévérité de dépression, qui doit être présente presque tous les jours pendant au moins deux semaines, le rapport bénéfice-risque attendu d’un antidépresseur devient favorable pour un épisode dépressif caractérisé non bipolaire, et plus l’intensité des symptômes est forte, plus ce rapport est favorable. Reste ensuite à déterminer les molécules les plus adaptées en fonction notamment de leurs contre-indications.

LP : C’est une question de curseurs, celui du temps et celui de l’intensité. Et il faut être un clinicien habile pour savoir quelle est l’intensité de la douleur vécue par un patient car les tests sont très difficiles à mettre en place et cela varie beaucoup selon les modes et la société. Au niveau du temps, le DSM (manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) prévoit en effet deux semaines. Mais une période de tristesse d’une quinzaine de jours empêchant le fonctionnement normal du sujet, familial ou social, on le voit tous les jours chez ses patients. J’allongerais donc bien ce curseur, mais il est sûr que l’on ne peut pas laisser quelqu’un dans cet état. Il faut au moins essayer de faire quelque chose. Pourquoi pas un médicament, et les antidépresseurs ont un effet symptomatique incontestable sur la tristesse, au moins chez la moitié des patients. Mais les benzodiazépines ou un verre de whisky auront un effet comparable. Donc en attendant d’avoir un diagnostic, on peut donner ce traitement symptomatique. Le problème, c’est : quels sont les bénéfices et les risques ? Car les antidépresseurs sont tout de même des médicaments dont on sait qu’il peuvent provoquer une dysfonction sexuelle, de l’agitation psychomotrice, des troubles cardio-vasculaires, des convulsions ou des hémorragies, entres autres. Certains de ces effets indésirables sont certes très rares, mais pour une bonne moitié des utilisateurs qui ne retire aucun effet positif du traitement, le bénéfice-risque ne peut qu’être négatif.
NH : La tristesse pathologique, quand bien même elle durerait plus de quinze jours, ne suffit pas seule à poser un diagnostic d’épisode dépressif caractérisé, selon le DSM. Il faut au minimum cinq symptômes sur neuf. La tristesse pathologique en est un, mais elle doit être associée à d’autres. Par exemple un sentiment d’auto-dévalorisation ou de culpabilité inappropriées, des pensées de mort, un ralentissement psychique et moteur, une perte de plaisir ou d’envie de pratiquer des activités habituellement plaisantes, une diminution de la concentration, le tout en rupture avec le fonctionnement du sujet. Notons d’ailleurs que la tristesse n’est pas obligatoire car environ 10% des épisodes dépressifs caractérisés se manifestent par une humeur irritable et non pas triste.
L’association d’un antidépresseur et d’une psychothérapie est idéalement indiquée pour une dépression caractérisée
N. Hoertel
Le premier traitement doit-il forcément être l’antidépresseur ? Demasi et Gøtzsche disent que les psychothérapies sont plus efficaces et réduisent par deux le risque de suicide alors que les antidépresseurs le doubleraient…
NH : Il y a beaucoup à redire sur cette affirmation. Une méta-analyse de 52 ECR incluant plus de 3.500 adultes a évalué l’efficacité de la psychothérapie et des antidépresseurs utilisés seuls, ainsi que de leur combinaison, dans les troubles dépressifs et anxieux. Avec un antidépresseur comparé à un placebo, il faut traiter cinq patients pour que l’un d’entre eux aille mieux grâce au traitement spécifiquement, c’est à dire que l’intensité de ses symptômes soit au moins divisée par deux, sachant que le taux absolu d’amélioration sous antidépresseur est bien sûr plus élevé, d’environ 50%. Pour une psychothérapie structurée, le chiffre est quasi identique. Mais quand on associe les deux, le nombre de patients à traiter est de 2,5. C’est ainsi deux fois plus efficace. Les recommandations internationales indiquent donc qu’une association des deux approches est idéalement indiquée pour la prise en charge de la dépression caractérisée. Malheureusement, les patients ont un faible accès en France à la psychothérapie, qui n’est remboursée que dans de rares cas. On constate donc une tendance à ne prescrire qu’un antidépresseur et à réserver la psychothérapie en cas d’échec de celui-ci. A l’inverse, de nombreux collègues psychothérapeutes, qui croulent sous des demandes de suivi, privilégient les patients prenant un antidépresseur dans cette indication, car ils observent que l’efficacité de la psychothérapie est alors meilleure.
LP : D’après ce que vous dites, la psychothérapie a toutefois un effet identique à celui de l’antidépresseur. Et dans le diagnostic idéal que vous avez fait, malheureusement rare en pratique, le traitement combiné des deux apparaît en effet optimum, d’après l’EBM, la médecine validée par les preuves. Le problème, c’est que l’on peut mettre en doute les résultats des essais cliniques dont les échantillons sont à mon avis toujours trop faibles. Il est en fait très dur de voir aujourd’hui de l’EBM sans biais pour un médicament avec un tel chiffre d’affaires et je doute que l’on ait des preuves suffisantes sur le long terme. Mais surtout, vous savez très bien que la prescription en vie réelle est bien supérieure à ce qu’elle devrait être avec ces traitements que j’appelle personnellement symptomatiques. Car l’antidépresseur n’est pas curatif, il lisse seulement l’humeur.
NH : En 2018, on disposait déjà de 522 ECR incluant 116.477 patients dont l’évaluation conjointe conclut à l’efficacité de ces traitements avec la bonne indication. Mais ce que vous dites est important et je reconnais les limites des ECR, notamment la faible représentativité des patients inclus. Donc en complément, j’apprécie les données des études observationnelles en vie réelle, qui mériteraient d’être plus nombreuses, mais confirment globalement cette efficacité, certes moins élevée que celle retrouvée dans les ECR, possiblement du fait de l’inobservance de certains patients. On ne peut pas non plus se contenter d’études qui ne s’intéressent qu’aux symptômes, il faut aussi voir l’effet des traitements sur les conséquences de la maladie. Par exemple, une étude récente analysant les données de 2.537 enfants et adolescents présentant une dépression caractérisée montre que la prescription d’un antidépresseur améliore davantage leur fonctionnement qu’un placebo. Concernant le suicide, une étude nationale ayant suivi 538.577 personnes prenant un antidépresseur indique que les comportements suicidaires sont plus fréquents avant le traitement et qu’avec ce dernier leur fréquence diminue au cours du temps.
D’autres résultats sont contradictoires, surtout chez les enfants et les adolescents. Le professeur David Healy en pointe un certain nombre qui montrent une absence d’efficacité sur cette population, avec au contraire des risques de suicide qui peuvent être augmentés mais aussi camouflés comme on a pu le voir avec le scandale de la fameuse étude 329 sur la paroxétine.
NH : Les données des ECR, du moins ceux évaluant le traitement à court terme, typiquement de 4 à 8 semaines, indiquent effectivement une association faible, chez les moins de 18 ans uniquement, entre la prescription d’un antidépresseur et des idées ou comportements suicidaires. Il faut cependant rappeler qu’un antidépresseur met généralement 2 à 6 semaines pour agir, et qu’il est difficile de déterminer si ces comportements sont attribuables à la dépression non encore traitée ou bien au traitement, d’autant que cette association n’est pas retrouvée chez les adultes. Je suis néanmoins tout à fait d’accord avec les recommandations actuelles qui indiquent que les antidépresseurs ne doivent pas être utilisés pour traiter la dépression chez l’enfant et ne sont pas non plus à prescrire en première intention aux adolescents, chez qui on doit les utiliser avec une très grande prudence.
LP : Au delà des méta-analyses d’ERC, le supposé gold standard de l’EBM, il faut évoquer une approche épidémiologique encore plus importante : la sociologie, qui présente le meilleur échantillonnage. Elle montre que le nombre de suicides chez les enfants et les adolescents n’a pas diminué dans les pays où la prescription d’antidépresseurs est la plus forte. Le nombre de dépressions y est aussi en augmentation. Nous sommes donc assez nuls en prévention, et penser que des médicaments, une chimie, peuvent régler ces problèmes comme le démontreraient de grandes études est contredit au niveau de la population.
Globalement, les traitements sont en échec. C’est une réalité, avec des médecins qui prennent des patients à vie
L. Perino
Passons au deuxième mythe que cherche à réfuter Natalina Salmaso : l’utilisateur dépendrait des antidépresseurs pour être heureux. Elle dit que ces médicaments permettent seulement de retrouver des émotions, alors que Demasi et Gøtzsche rétorquent que l’on perd au contraire en émotion et se retrouve engourdi. Quel est en fait l’effet émotionnel des antidépresseurs ?
NH : Dire que les antidépresseurs rendraient engourdis ou supprimeraient les émotions est une idée reçue. Au cours de l’épisode dépressif caractérisé, on observe généralement un émoussement, une diminution des émotions, ainsi qu’une balance émotionnelle modifiée, avec un ressenti plus fort des émotions négatives et une moindre capacité à ressentir les émotions positives. Le traitement antidépresseur ne rend ni heureux ni malheureux, il favorise, en réduisant les symptômes dépressifs, un ressenti émotionnel progressivement plus équilibré. L’idée que l’émoussement des affects serait un effet indésirable des antidépresseurs et non un symptôme dépressif est contredite par plusieurs ECR qui constatent que la fréquence de ce symptôme est toujours plus forte au début des essais, avant même la prise du traitement, et diminue progressivement ensuite.
LP : Votre discours de vrai professionnel qui fait des études m’inquiète. Vous parlez d’humeur, d’émotion, mais quand on fait des ECR, on est dans la statistique pure. Or les critères doivent être très précis. Par exemple, le taux de glycémie a-t-il augmenté ou diminué ? On a déjà très peu de certitude avec ça sur l’évolution d’un diabète de type 2, mais là, vous parlez d’émoussement affectif sur des gens suivis même pas une fois par mois par un généraliste, et encore moins souvent par un psychiatre. Même dans le cadre d’une étude où on les voit tous les jours, les critères sont imprécis, basés sur des symptômes la plupart du temps plus subjectifs qu’objectifs. Selon moi, on se trouve face à impossibilité à produire des preuves aussi précises que vous le dites sur ces médicaments. Mais ces preuves existent car la puissance du marché est telle qu’on peut les acheter. Je comprends, approuve et apprécie votre esprit scientifique, mais je me situe en amont de ce processus. Même pour des maladies beaucoup plus concrètes avec des symptômes objectifs, on n’arrive pas à avoir de la bonne épidémiologie. Vous citez des études et je connais bien l’EBM, un sujet sur lequel j’ai écrit. Mais je me place au-dessus de l’EBM pour faire de l’épidémiologie globale de la psychiatrie et de la dépression. Dans nos pays, le nombre de diagnostics ne cesse d’augmenter. Globalement, les traitements sont en échec. C’est une réalité, avec des médecins qui suivent des patients à vie. Vous évoquez aussi des effets secondaires, mais on est nul en pharmacovigilance, et pas seulement pour la psychiatrie. On l’est aussi pour les thérapeutiques cardio-vasculaires ou anti-cancéreuses. Donc il s’avère difficile de faire de la science exacte là-dessus. Cela n’empêche pas que vous essayiez d’en faire à votre niveau, et c’est très louable. Mais au niveau de la santé publique, on est totalement à la dérive. Des gens comme Gøtzsche réfléchissent aussi à ce niveau là, mais sans arriver à donner des preuves, ce qui fait qu’ils se placent également au-dessus. C’est normal, car ils sont tellement atterrés par ce qu’ils voient qu’ils sortent du registre de la science pure.
NH : Quand on affirme qu’un médicament n’est pas efficace et dangereux, voire mortel, il faut être conscient des conséquences potentielles terribles pour les patients si l’on a tort. J’estime donc important de ne jamais sortir du registre de la science, ni même de l’EBM qui n’est pas uniquement fondée sur les données de la littérature, d’après la description qu’en a fait David Sackett, l’un de ses pères fondateurs. L’EBM intègre également la préférence du patient, à qui l’on doit une information claire, et l’art médical issu de l’expérience du praticien et de celle qui lui a été délivrée par ses pères. De cette interaction doit naître la prescription d’un traitement. Je suis d’accord avec vous : les ECR ne donnent qu’une partie de la vérité. Leurs critères d’exclusion, utilisés afin de s’assurer que le médicament testé est efficace sur la pathologie étudiée, limitent la représentativité des patients inclus comparativement à la population cible de ceux à qui sera prescrit le médicament. Notre équipe a d’ailleurs pu montrer que les ECR en psychiatrie excluaient généralement une proportion importante voire la majorité des sujets présentant le trouble en population générale, et ceci est également vrai pour les autres disciplines médicales. D’où l’importance des études observationnelles dites de phase IV en complément des ECR, qui ne devraient pas se limiter à l’étude de la sécurité du médicament comme c’est le cas aujourd’hui, mais également en étudier l’efficacité, notamment chez les patients typiquement exclus des ECR. Chez ceux présentant une dépression caractérisée, souffrir de plusieurs pathologies augmente le risque d’effets indésirables et réduit la probabilité de réponse aux antidépresseurs, donc modifie la balance bénéfice-risque. On doit en avoir conscience. Cela dit, il est évidemment possible que des prescriptions ne soient pas suffisamment motivées médicalement, mais en 2019, plus de 4,2 millions de Français, soit 6,3 % de la population générale, se sont vus prescrire un antidépresseur. Un chiffre en fait plus faible que ne laisseraient attendre ceux de la prévalence de leur principales indications, à savoir la dépression caractérisée et les troubles anxieux, estimée respectivement à 5% et 4%. Des études indiquent d’ailleurs que la dépression caractérisée survenant chez les personnes âgées est souvent non détectée ou insuffisamment traitée. Or tout comme il est primordial de ne pas médicaliser la tristesse, il est important de ne pas rationaliser le fait qu’il serait normal d’être dépressif quand on est âgé, et de choisir de ne pas intervenir alors que l’on dispose de traitements efficaces, psychothérapeutiques et médicamenteux.
LP : Ces pourcentages important doivent tout de même nous inquiéter sur l’état mental et psychique de nos concitoyens. Pour autant, je crois ces chiffres excessifs, notamment du fait d’une confusion chez nombre de médecins. D’une part avec les troubles bipolaires qui ne doivent pas être traités avec des antidépresseurs, d’autre part avec les dépressions dites réactionnelles à un événement malheureux de la vie courante qui guérissent spontanément sans avoir besoin de traitement. C’est avant tout une question de diagnostic, et il est rare en psychiatrie qu’il fasse l’unanimité. J’en reviens donc à ma première recommandation : tout traitement sans diagnostic précis est abusif.
Ce n’est pas l’antidépresseur qui augmente le risque de suicide mais l’anxiolytique que l’on donne avec
N. Hoertel
Selon le troisième mythe, les antidépresseurs vous nous changer en nous rendant « high », soit défoncés. Natalina Salmaso dit qu’ils rendent au contraire plus équilibré, tandis que Demasi et Gøtzsche soutiennent que ces médicaments affectent bien la personnalité. Là encore, qu’en est-il ?
LP : On ne peut pas dire que l’on serait défoncé en prenant ce médicament, ni prétendre que l’on se sentirait beaucoup mieux. C’est tellement subjectif. Quand l'EBM observe une amélioration de l'humeur, je veux bien le croire, mais il n'existe pas de preuve, à ma connaissance, d'un effet qui "défoncerait"
Mais qu’en est-il du changement de personnalité ?
NH : Les antidépresseurs n’affectent pas la personnalité. La dépression caractérisée, elle, en revanche, le peut. Une étude publiée par le Dr Gøtzsche et ses collaborateurs dans le BMJ indique d’ailleurs que chez les adultes, il n’est pas retrouvé de lien entre prises d’un antidépresseur et comportements agressif ou suicidaire. Cette publication suggère, cependant, un lien spécifiquement chez les enfants et adolescents, probablement expliqué par l’absence de prise en compte de l’indication du traitement antidépresseur dans ces essais, notamment les troubles du spectre autistique et le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Cette association n’est d’ailleurs pas retrouvée dans cette population des enfants et des adolescents dans une méta-analyse plus récente. Par ailleurs, aucune donnée ne supporte l’idée qu’un antidépresseur pourrait rendre “high”, mais la prise parfois concomitante de toxiques, tels que le cannabis, les amphétamines ou l’alcool, elle, le peut. Le mésusage d’un autre type de psychotrope que les antidépresseurs, les benzodiazépines, appelées souvent anxiolytiques, peut également s’accompagner de troubles du comportement, à type de désinhibition avec impulsivité, pouvant majorer le risque suicidaire.
LP : Des benzodiazépines qui ont longtemps été fortement recommandées en co-prescription avec tous les antidépresseurs. Ce qui prouve nos précipitations passées dans le domaine de la pharmacologie psychiatrique.
NH : Oui, on les a notamment prescrits dans l’espoir que ce traitement réduirait le risque suicidaire en attendant les 2 à 6 semaines que mettent généralement les antidépresseurs à agir… Et en 2015, environ 13,4% de la population française avait pris au moins une fois une benzodiazépine, en en faisant le psychotrope le plus consommé en France, très loin devant les antidépresseurs. Le mésusage des benzodiazépines est aujourd’hui encore un enjeu majeur de santé publique. Un véritable fléau.
A suivre…
Ici la seconde partie du débat entre Nicolas Hoertel et Luc Perino.




